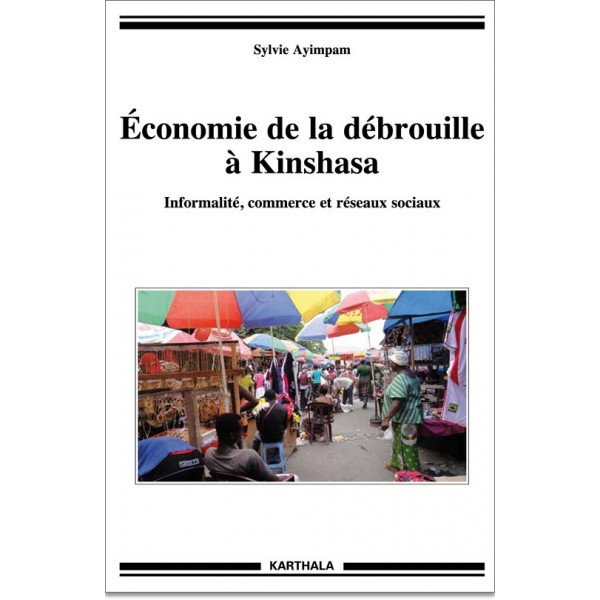
Economie de la débrouille à Kinshasa. Informalité, commerce et réseaux sociaux, par Sylvie Ayimpam
Economie de la débrouille à Kinshasa. Informalité, commerce et réseaux sociaux est un ouvrage académique de science politique visant, en utilisant une série d’enquêtes de terrain dans les marchés de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. Ce travail de Sylvie Ayimpam est issu de sa thèse. Il s’agit du résultat de plusieurs enquêtes de terrain, de type ethnographique, auprès d’acteurs de la sphère de cette économie informelle, sur plusieurs années. En utilisant une méthode immersive, de nombreuses observations et entretiens, l’auteure fut en mesure de dégager des résultats scientifiques “par le bas”, c’est-à-dire en utilisant les perceptions et réalités particulières avant de remonter vers des conclusions plus globales.
Elle construit, à partir de ses observations mises en relation avec la littérature sur son sujet, une double problématique. Elle constate que la littérature, quand elle se rapporte à l’économie informelle ou « parallèle », l’aborde sous le prisme d’un problème économique et d’une pratique déviante et néfaste, ainsi que d’un manque de modernité qui dénoterait une évolution moindre des sociétés qui la pratiquent. Au contraire, Ayimpam cherche à se débarrasser de tout jugement ou prénotion sur cette question. Elle applique des concepts basiques des sciences sociales et les adapte à son terrain. Sa double problématique prend donc le contre-pied des insuffisances théoriques qu’elle observe : elle prend le phénomène par le bas, en l’abordant comme une pratique sociale comme les autres, qui a ses causes, ses tenants et ses aboutissants, qu’il s’agit d’observer d’un point de vue neutre de sociologue ; elle décide aussi de sortir de la vision purement économique de l’informel pour s’intéresser à sa teneur éminemment politique, car dans un pays et dans une ville où le politique est largement corrompu, et n’a pas de pouvoir coercitif majeur, on ne peut pas aborder le problème de la même façon que dans les pays du Nord où le politique est perçu comme tout puissant. Elle décide donc d’aborder l’économie informelle comme un moyen d’auto-régulation de la société, un moment où des règles sociales compensent ce que des règles légales et institutionnelles ne sont pas en mesure de faire. L’auteure étudie donc avant tout des pratiques dans un espace social qui a, en définitive, ses règles, ses conventions, qui structure l’espace de vie des personnes qui constituent ce qui est, nous le verrons, un champ à part entière au sens de Bourdieu (1).
Pour aborder son objet, l’auteure a découpé son travail en 8 chapitres dans trois parties. La première présente l’histoire de la République Démocratique du Congo et de Kinshasa ainsi que les marchés qu’elle va étudier. Nous n’analyserons pas cette partie car il ne s’agit que d’une contextualisation. Elle consacre une seconde partie à la structure en réseaux du circuit de commercialisation et à la circulation des flux, économiques, politiques et symboliques. Enfin, elle s’intéresse à l’instance de socialisation que constitue les marchés qu’elle étudie, et comment ils deviennent des instances de régulation.
La « débrouille » : réseaux sociaux et mise en circulation de capitaux
Une des premières prénotions que l’auteure dément est la croyance selon laquelle l’économie informelle serait un phénomène local, assez primitif et facilité par une relative inaction des pouvoirs publics. Elle montre en substance le caractère à la fois complexe et intégrateur d’un tel commerce.
Un capital social de la « débrouille » dans un champ en dehors de l’Etat
Tout d’abord, Ayimpam montre qu’il existe tous types de commerces informels, avec des marchandises venant en très grande partie de l’extérieur de la ville, voire de l’étranger. Ce sont aussi bien des produits alimentaires manufacturés, aussi bien que des articles de subsistance ou de loisir. Ensuite, elle montre l’organisation et la complexité d’un tel commerce. Cela est particulièrement vrai avec le commerce du manioc : elle étudie la façon dont il se négocie sur les « parkings » du port. En effet, le manioc qui arrive par bateau à Kinshasa est censé être taxé, si bien que beaucoup de commerçants essaient de payer moins cher en échappant aux « agents des taxes » -la taxe représentant ici un pot de vin-. Mais savoir où et quand retrouver un bateau qui vendra le manioc sur le parking semble être un exercice difficile. D’autant plus qu’il faut le faire rapidement pour que les agents des taxes ne viennent pas en prélever. C’est grâce à un réseau social très intégré que les acheteurs-commerçants sont sur le lieu de la vente avant même qu’elle n’ait lieu. La possibilité pour eux de faire les meilleurs « deals » dépendent de leur accès à l’information et donc de leur intégration aux réseaux d’acheteurs et de vendeurs. La légitimité de telles pratiques vient du fait que la définition wébérienne(2) de l’Etat ne peut pas s’appliquer ici. Il est en situation de concurrence par rapport à l’organisation de l’importation et du commerce des marchandises. Le formel et l’informel, quoique de fait imbriqués, proposent deux ordres et deux organisations sociales en lutte constante. Parfois, l’Etat perd totalement. Par exemple, dans le cas des passeurs handicapés, aucun contrôle ne peut être effectué, ces derniers étant en mesures de faire passer n’importe quelle marchandise grâce à leur statut. Ils ont de fait le monopole de l’importation de « super solo », tissu asiatique illégal.
L’économie de la « débrouille », symbole de modernité ?
Mais cet exemple montre aussi que l’économie kinoise est mondialisée, et c’est pour cela que les régulations mises en place par le gouvernement congolais pour privilégier les produits locaux échouent face à une offre internationale qui offre de bien plus grands avantages, malgré le coût du passage de la marchandise. En ce sens, les marchands de « super solo » sont les agents du néo-libéralisme sans s’en rendre compte. Alors la pratique de la vente de produit hors du cadre de la loi est en fait une preuve que la société kinoise adapte sa modernité en fonction de ses coutume et de ses traditions. La SAPE (Société des Ambianceurs et Personnes Élégantes), primordiale dans la société kinoise post-coloniale, est une façon de montrer un certain statut social avec des articles vestimentaires de style, très colorés et de qualité. Le but est de montrer son statut par sa capacité à acheter de beaux vêtements, c’est un répertoire de subjectivation à part entière. Mais cette pratique a un coût très important. Les marchands de rue, dans la frippe comme dans l’importation de tissus asiatiques par exemple, qui semblent être des formes d’activités économiques très primitives pour un Occidental, permettent aux kinois de se « saper » à moindre coût, et donc de s’intégrer voire de s’élever socialement. Il existe des pratiques de réduction des coûts similaires dans toutes les sociétés.
De plus, les marchands de rue sont de vrais entrepreneurs. Ils apportent de la richesse à leur pays par leur consommation, certes, mais ils ont surtout mis en place un vrai système de crédit qui permet de multiplier l’activité. En effet, le tissu des marchands de rue est très varié, il ne faut donc pas en avoir une vision misérabiliste. Il existe une hiérarchie des différents types d’acteurs. Les fournisseurs, des grossistes, des semi-grossistes, des gros vendeurs, des petits, de revendeurs, des acheteurs particuliers, des acheteurs professionnels qui vont ensuite revendre les produits dans des boutiques légitimes. Tous ces acteurs sont en constante transaction financière avec des moyens très hétérogènes. Tous n’ont pas cependant les moyens d’acquérir leur marchandises, même s’ils ont par la suite les connections pour les revendre. Néanmoins le marché de rue n’est pas un marché stable, et il fonctionne comme une place boursière : ce sont des placements à haut risque mais avec des bénéfices potentiels très importants. Ce sont les grossistes et les semi-grossistes qui vont alors le plus vendre à crédit à des petits vendeurs et des revendeurs dans le but d’augmenter leur mise. Toutefois cette bourse de rue n’a pas d’indicateur de confiance, et l’incertitude fait que c’est par la connaissance et le capital social que les crédités diminuent l’incertitude des créditeurs. Ainsi l’indicateur de confiance, comme le reste de cet éco-système financier, passe par l’informel, par des attributs subjectifs, et surtout par des relations construites sur le temps long. En utilisant des concepts scientifiques et en les détachants de nos prénotions, on peut montrer que les sociétés post-coloniales sont compatibles avec la modernité, la preuve : elles se l’approprient.
Commercer pour mieux régner : la « débrouille » régulatrice par le social
L’intérêt du commerce de la débrouille au quotidien est aussi qu’il est un formidable moteur d’intégration sociale. Il s’agit d’un champ à part entière avec ses enjeux, ses valeurs, ses pratiques légitimes et ses pratiques déviantes. Derrière l’informalité apparente se cache un grand nombre de règles, avec un capital social du marché propre et une vraie hiérarchie sociale.
Les leaders derrière les étals
L’auteure met en exergue tout au long de son livre des portraits de personnages qui, dans leur petit monde social, ont une vraie fonction de régulation sociale par leurs pratiques économiques. Nous allons en montrer quelques exemples.
La première figure marquante de ces marchés est celle des basi ya kilo, ou ba soeurs ya poids « les femmes qui pèsent », « les patronnes ». Dans une société très machiste où les hommes dirigent la plupart des activités, leur statut de femmes fortes et leur habitus particulier leur ont permis d’acquérir un statut social supérieur au sein du marché. Ce sont avant tout des business women à l’activité internationale. Ce sont les patronnes, et un exemple majeur de réussite féminine en Afrique. Elles ont une place centrale sur le marché, dans les pavillons les plus prestigieux elles commercent directement, dirigent des hommes. Elles sont des chefs de réseaux sociaux et ont beaucoup de prestige. Elles font souvent partie de tontines (3) et voyagent constamment entre l’Europe et l’Afrique pour leurs affaires. Être une de ces femmes est prestigieux, difficile, et leur donne un poids tant économique que social ou politique.
A l’opposé de ce modèle de réussite individuelle basé en très grande partie sur le commerce d’un seul produit, dans son exemple le textile, l’auteure présente un autre exemple de réseau social du marché autour d’un acteur central, qu’elle appelle Sam, un revendeur, qui est cette fois beaucoup plus intégrateur. Cet homme s’est entouré de très nombreuses personnes complémentaires pour contrôler quasiment toute la chaîne de distribution de produits très divers. Il dépend de fournisseurs internationaux, de Dubaï, Honk-Hong ou encore Brazzaville, mais aussi des fournisseurs locaux. Ses coursiers, maliens, lui ramènent des produits en fonction de la conjoncture, et il utilise des immigrants indiens ou pakistanais pour les revendre dans ces magasins et sur le Marché Central.
Ces deux exemples montrent que c’est la sociabilité et des stratégies individuelles et collectives qui sont à l’origine de leur réussite. Le capital social nécessaire ne s’acquiert pas dans des universités ou pendant des évènements professionnels mais lors d’évènements collectifs. L’auteure parle de sociabilité cérémonielle. Souvent, c’est lors d’évènements avec la famille élargie ou dans des tontines que les relations sur lesquelles le business se base se lient. Ces liens tissés sont « économiquement fonctionnels », se concrétisent souvent par une dette ou un patronage, et demandent un fort investissement en termes de temps et d’argent. Le marché qui était à la base le lieu d’une économie de débrouille est un nid à succès. Les relations sociales sont très intenses dans cet environnement où tout le monde se connaît et où il est difficile de commencer sans les bonnes relations et quelqu’un pour vous prendre sous son aile.
De ce fait, il y a beaucoup de logiques de solidarité dans le marché, mais pas que.
La déviance intégratrice : de la solidarité à l’arnaque
L’auteure explique en quoi le « tissage » du lien social est particulier et qu’il est primordial de d’expliciter. En effet, nous avons vu comment les relations économiques et sociales entre les acteurs du marchés étaient intimement liées. Ayimpam explique que la solidité de ces relations est construite sur le temps par des relations économiques sous formes de dons et de contre-dons, dans la veine des travaux de Marcel Mauss. Dans un contexte de précarité et d’incertitude amené par l’informel, compter sur les gens avec lesquels ils travaillent est primordial pour les marchands. Il devient nécessaire pour eux de diminuer les risques en nouant de relations de confiance, par l’argent, et par des dettes soit monétaires soit symboliques, qui forment des chaînes de solidarités successives et créent petit à petit de la confiance.
Néanmoins, l’incertitude est toujours très forte étant donné que le contrôle social reste informel, que les contrats passés entre les acteurs sont oraux et les clauses implicites. Ainsi, il n’est pas rare que des marchands ou des grossistes se fassent arnaquer, par une absence de remboursement. L’auteure donne l’exemple de mamas bonheur qui ont été arnaquées par des revendeurs pourtant réguliers. Dans ce genre d’affaire, l’économique prend une dimension émotionnelle et symbolique très forte. De fait, les personnes ayant commis les larcins perdent la confiance, non seulement des mamas bonheur, mais de tout le marché, et par conséquent de tout leur réseau, car l’information passe par la rumeur. Plus la personne est centrale dans le marché, plus l’arnaque a un coût élevé pour l’arnaqueur.
Une des traductions du ressentiment sur le marché est le recours à la sorcellerie. C’est une méfiance réciproque latente à toute tension dans toute la ville d’après l’auteure. La sorcellerie est vue ici comme percécutive, c’est un moyen d’expliquer par l’occulte le manque de fortune d’une personne, un échec, et c’est un exutoire pour la société qui peut alors lancer de gigantesques chasses au sorcier. Mais c’est aussi une manière de légitimer sa jalousie, en particulier envers des proches.
Un système néanmoins fragilisé
Ce système que nous venons de décrire repose sur l’informel. Si, pendant tout son ouvrage, l’auteure a décrit un système social complexe avec ses valeurs, ses règles, ses croyances, elle conclut en rappelant que l’informel n’est pas très solide. La régulation n’est faite par aucune autorité, chacun doit se créer son réseau et participer à la générosité collective sans être certain des résultats. Chacun doit se faire justice lui-même, souvent en fonction de ses moyens sociaux et financiers. C’est pour cela que la sorcellerie est mobilisée, sur ce socle social meuble, les acteurs bâtissent des croyances qu’ils croient solides, et quand les insuffisances du système créent des résultats inattendus ou décevants, il n’y a pas d’explication qui fasse sens à part celui de l’occulte.
L’informel fait donc partie d’un enchevêtre de logiques sociales différenciées, ce qui lui donne un caractère semi-régulateur. L’auteure conclut en disant que le rôle de l’informel est celui d’une « gouvernance hybride » de montrer que, dans les sociétés post-coloniales, la gouvernance passe par d’autres moyens.
Rémy Gendraud
Notes
- Bourdieu Pierre. “Le champ scientifique”. In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 2, n°2-3, juin 1976. La production de l’idéologie dominante. pp. 88-104.
- “L’État est cette communauté humaine, qui à l’intérieur d’un territoire déterminé (…) revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime”. Max Weber, Le savant et le politique, trad. de l’all. par Catherine Colliot-Thélène, Paris, La Découverte, 2003, « La politique comme profession et vocation », p. 118.
- Une tontine est une association ou un collectif d’épargne, rassemblant des épargnants, et dans le cas des basi ya kilo, des épargnantes, dont la propriété et le contrôle sont entre les mains d’une partie des épargnants. Elles sont utilisées ici comme moyen d’épargne et aussi comme aide à l’autonomisation féminine.





No Comment